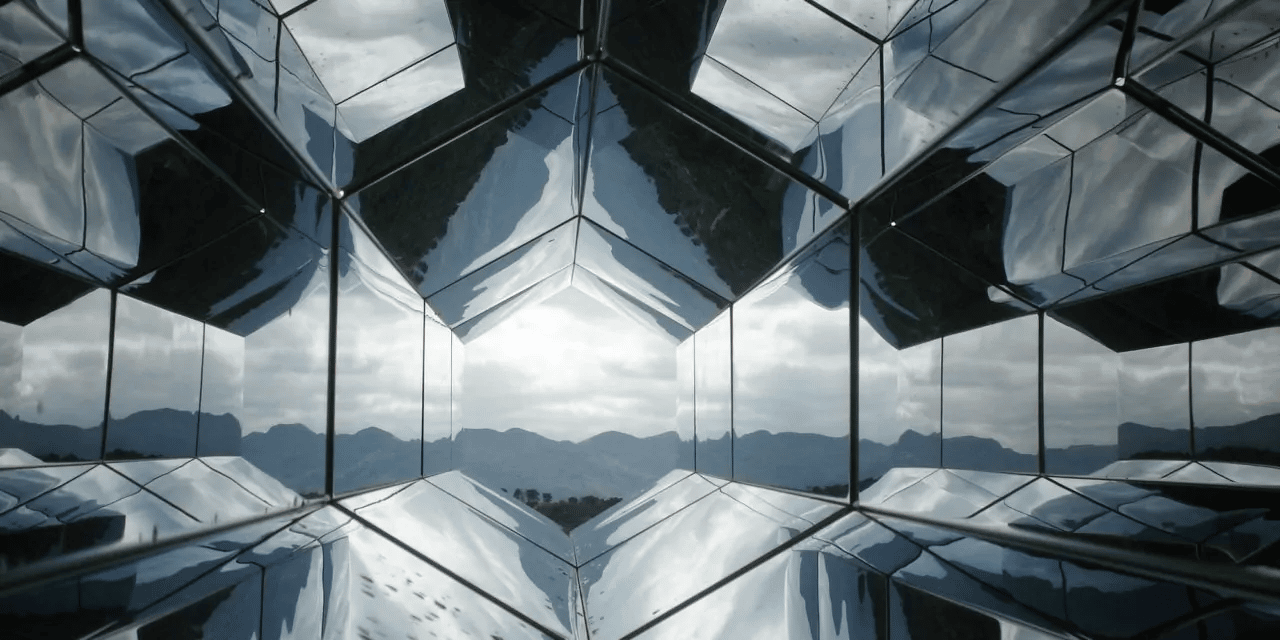Beaux, élégants, esthétiques, certains Salons français comme Première Vision ou la Biennale des Antiquaires font parler d’eux pour la recherche et la sophistication de leurs espaces. Quels sont les points communs, les grandes règles qui régissent la conception des espaces de Salons et que l’on pourrait qualifier de principes esthétiques spatiaux ? Comment l’esthétique spatiale du Salon peut-elle répondre aux enjeux des Salons et leur transformation ? Une réflexion autour de la sérendipité et de l’esthétique du hasard heureux qui semble être une réponse au besoin des visiteurs et professionnels toujours à la recherche du coup de cœur inspirationnel.
Une esthétique historique en opposition à une fonction qui évolue
Lorsque l’on observe les plans des différents salons et leur construction, on remarque des constantes comme :
• le morcellement de l’espace en un motif de grilles
• la définition de grandes zones thématiques
• les systèmes d’allées desservant les différents espaces cloisonnés (vitrines ouvertes)
• les îlots indépendants d’exposition (conférences / expositions / événementiel)
• des galeries de passage en périphérie utilisées comme accès vers l’extérieur ou encore comme aires de repos improvisées.
Ces règles se sont établies au cours du temps dans le but de répondre à la fonction première du Salon qui est de permettre la rencontre certaine et efficace entre une offre et une demande. Ce format de rencontre ordonné (et prévisible !) est aujourd’hui challengé par le besoin croissant d’un petit plus, du moment particulier qui va augmenter l’expérience de visite d’un salon. Plus de sensation, de magie ou d’expérience pour les visiteurs, mais surtout un réel besoin de découverte, de surprise du côté des professionnels pour ouvrir leur point de vue et créer de nouvelles connexions business.
« Un réel besoin de découverte, de surprise du côté des professionnels pour ouvrir leur point de vue et créer de nouvelles connexions business. »
On remarque d’ailleurs le succès notable des îlots indépendants à la scénographie unique fonctionnant comme des bulles d’inspiration, d’exposition ou de tendances venant aérer à la fois visuellement et intellectuellement la structure cyclique du Salon. Leur conception cherche à faire une vraie proposition de contenu différente de celle qui est proposée sur le reste du Salon :
• soit en bouleversant les codes d’échanges entre professionnels qui ne se réduit plus à se retrouver autour d’un verre au salon VIP, comme le propose le Designer’s Studio à Maison & Objet
• soit en proposant des associations exceptionnelles de produits ou de services pour surprendre et inspirer les professionnels en les sortant de leur zone de confort, comme dans l’exposition Silence de Maison & Objet.
Mais la majorité de l’espace du salon construit dans son esthétique classique, ordonnée et même répétée d’année en année, amoindrit finalement les opportunités de surprise et, quand elle est trop rigide, ternit même la visibilité des marques en leur imposant sa rigueur et son style. La dimension de surprise est alors très réduite, les professionnels préparant à l’avance les stands qu’ils veulent visiter et ne se laissant pas aller à l’“errance”.

L’esthétique de sérendipité : l’errance heureuse
Cette notion d’errance ou de hasard heureux est représentée par le terme de sérendipité. Terme à la mode depuis quelques années, et issu de serendipity, il signifie « don de faire des trouvailles » ; un état d’esprit à cultiver pour faire des trouvailles, mais souvent refoulé par les chercheurs qui ne veulent pas être considérés comme des chercheurs par hasard. L’un des auteurs du livre (Sérendipité, mot de l’année – Emmanuel Lemieux, Sciences Humaines), Pek van Andel, vante cette démarche : dans son pays, “les chercheurs ont le droit à leur vendredi pour méditer et se livrer aux délices de la sérendipité.” Il semble que la sérendipité devienne une dimension esthétique essentielle à prendre en compte dans la conception de la structure globale du Salon et de ses allées de passage afin d’introduire des notions de flexibilité, fluidité et hasard entre les univers présents dans l’espace du Salon et déclinés sur les stands. Mais comment se définit une esthétique de sérendipité ? Que nécessite-t-elle ? Les temples de la sérendipité aujourd’hui sont les concepts stores tels que le rez-de-chaussée de Merci, les magasins Fleux ou encore le fameux Colette qui a fermé ses portes récemment.
Ces lieux, qui sont en réalité la version moderne de la bonne vieille droguerie, maîtrisent avec brio le mélange des genres et la déambulation spatiale pour suggérer, surprendre, amuser le consommateur qui rentre dans leurs multiples univers. Les espaces ne s’alignent pas, s’élargissent, se rétrécissent et aboutissent sur de grandes places, avec de multiples recoins pour permettre les découvertes fortuites. L’esthétique de sérendipité repose en réalité moins sur la gestion de l’espace que dans la curation des produits et des marques exposées. La sélection autour d’une direction artistique cohérente et la restriction de l‘espace disponible favorisent la qualité et le renouvellement des exposés et facilitent la créativité permettant ainsi de mieux mettre en valeur. Les profils de curateur et de designer spatial travaillant en étroite collaboration prennent alors un rôle central dans la construction de tels espaces. Evidemment il est difficile de réellement comparer les concept stores et les Salons ; les enjeux et les business étant très éloignés les uns des autres. Mais si l’on revient à cette notion de hasard heureux, l’anecdote d’une grand-mère rencontrée sur le salon de Création et Savoir-Faire :
« Ils m’ont perdue à tout changer de place mais j’ai trouvé plein de nouvelles choses ! »
Finalement, le hasard heureux peut aussi commencer par une histoire de chaises musicales.